DBA (Doctorate of business administration). Professeur de Management, de Marketing et d’ Entrepreneuriat.L’entrepreneuriat et l’écosystème entrepreneurial ne se décrètent pas !

Pourquoi et comment réussir ? L’expérience Québécoise
Pour le Dr. Rachid Rouane, le développement économique et social d’un pays est largement tributaire de ses entrepreneurs dotés de compétences managériales (analyse, vision, stratégie, action, leadership entrepreneurial et managérial, etc).
Ces entrepreneurs jouent, selon lui, le rôle de catalyseur de création d’emplois et de richesses. Cependant, comme le dit si bien cet adage (une main seule n’applaudit pas), ces entrepreneurs sont dépendants d’autres acteurs qui partagent les mêmes objectifs et qui travaillent en symbiose dans un même environnement appelé écosystème entrepreneurial et des startups. Ainsi, l’objectif de ce document est de définir l’écosystème entrepreneurial et ses différents acteurs.
De plus, l’étude tente de comprendre le rôle de l’écosystème entrepreneurial dans la promotion de l’activité entrepreneuriale en Algérie et Québec en prenant en considération les efforts déployés par les gouvernements, notamment l’appui aux initiatives d’accompagnement et de financement. L’étude fait ressortir l’importance de l’enseignement de l’entrepreneuriat du primaire au secondaire. La recherche scientifique actuelle sur l’écosystème entrepreneurial et des startups est en progression à l’échelle mondiale.
Introduction
Le contexte économique et social mondial (guerre, inflation, chômage, pauvreté, réchauffement climatique, Top technologie, etc) fait pression sur les gouvernements et les Etats à trouver des solutions durables et innovantes. Ainsi, les politiques et les fonctionnaires veulent transformer les populations notamment les jeunes en entrepreneurs à travers un ensemble de programmes et dispositifs incitatifs à l’entrepreneuriat et à l’innovation par la création d’entreprise (startups de différents types). Malgré les efforts fournis et les sommes investis, les résultats restent loin des objectifs escomptés1. D’après quelques sources, les startups en Algérie sont confrontées à des défis tels que l’accès au financement, la complexité du paysage réglementaire, le manque de compétences spécialisées et de talents qualifiés, ainsi que la concurrence sur le marché local et international.
Ainsi, ce qui suppose plusieurs omissions des gouvernements, par exemples de ne pas admettre qu’entreprendre est un talent individuel, une passion, il faut des idées dont certaines sont bonnes, d’autres pas, un entrepreneur réussit ou pas. D’ailleurs, lui-même ne sait pas, au début, si son idée est viable et que les conso-acteurs et le marché en décideront.
L’entrepreneuriat ne s’impose pas et ne s’apprend pas non plus, il faut une vocation pour devenir entrepreneur, on y « accède » par la persévérance, le travail acharné, l’éducation entrepreneuriale et la formation continue. Il n’y a pas de quotas chez les entrepreneurs : on l’est ou on ne l’est pas. On ne crée pas des entrepreneurs. On ne décide pas de qui va le devenir ou non. Alors, vouloir fabriquer des entrepreneurs, réduire les peurs de se lancer ou accepter l’échec et d’ordre personnel, laissons-les choisir leur vocation. Malgré ces quelques raisons, les pouvoirs publics soutiennent et encouragent les différents types d’entrepreneuriat (création d’entreprise, PME, start-up, etc) comme moyen de répondre à la demande d’emplois et à la création de la richesse, notamment les startups technologiques.
Dans le même ordre d’idée, mon pays l’Algérie a multiplié les efforts à développer un écosystème entrepreneurial et des startups propice et solide à travers la diversification et la multiplication des dispositifs dédiés à la création et au soutien des start-up et dans l’objectif de faire de ces dernières la locomotive de la transition de l’économie algérienne d’un système rentier à un modèle reposant sur d’autres secteurs productifs et une économie de la connaissance , notamment le secteur du numérique et des nouvelles technologies, et d’impliquer les start-up pour contribuer à trouver des solutions aux enjeux stratégiques du pays (sécurité hydrique, transition énergétique, sécurité alimentaire, etc.)
Pour ce faire, le Gouvernement s’est engagé à promouvoir l’écosystème des startups et de l’économie numérique, à travers un ensemble d’actions2 (Voir en annexe). Certes importantes mais insuffisantes, car je trouve que seul le volet finance est dans ce nouvel écosystème, dont l’unique but de garantir les mécanismes de financement adéquats, alors que d’autres actions sont indispensables pour que les acteurs à charges de ce volet vont jouer convenablement leurs rôles et réaliser leurs tâches sans complaisances au sein de ses organismes financiers. Le bon comportement des acteurs à l’égard d’un écosystème entrepreneurial performant est produit par une conviction, une croyance et un esprit d’entreprendre et un esprit d’équipe, un ensemble de valeurs, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-agir qui orientent et façonnent l’action. Ce comportement adéquat qu’on veut avoir découle d’une culture entrepreneuriale. Bien que la culture entrepreneuriale favorable, n’est pas un fruit d’un hasard ou d’une décision quelconque, c’est par l’éducation scolaire étant enfant, adolescent et jeune par l’intégration de l’enseignement de l’entrepreneuriat du primaire au lycée en passant par le collège (CEM) comme l’ont fait d’autres pays (USA, Espagne, Québec…) leaders mondiaux en entrepreneuriat.
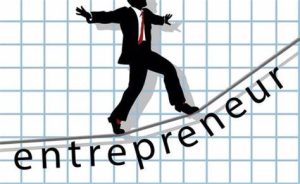
Alors, est-il raisonnable de promouvoir la création d’entreprise (startup) sachant bien que c’est un processus complexe et risqué exigeant un écosystème entrepreneurial favorable, notamment une culture entrepreneuriale chez les acteurs dans la société ou les startups vont naitre et évoluer. De même, il convient d’examiner de plus près la nature des intentions entrepreneuriales déclarées par les cibles et de vérifier leur éventuelle concrétisation : les jeunes par exemples sont-ils capables d’entreprendre, même lorsqu’ils sont peu expérimentés et peu qualifiés ou formés ? Quels sont les freins qui les empêchent de se lancer en création de start up malgré les avantages offerts par les gouvernements ? (Financement, incubateurs et accélérateurs).
Les meilleures startups ne réussissent pas seulement parce qu’elles proposent un excellent bien ou service, mais ils ont une compréhension approfondie de l’écosystème dans lequel ils opèrent et de la manière d’en tirer le meilleur parti.
Ce constat nous conduits à poser ces questions : Est-ce que l’entrepreneuriat sous toutes ses formes se décrète ? Comment faire pour réussir à ancrer et développer un entrepreneuriat de tout type ? Pourquoi dans certains pays (Québec) l’entrepreneuriat est florissant ?
Comprendre ce phénomène entrepreneurial observable, nous avons utilisés la méthodologie de recherche exploratoire qualitative et une recherche documentaire. Nous avons choisi un échantillon non probabiliste entre le Québec et l’Algérie composé de 12 acteurs impliqués dans le processus entrepreneurial. Une discussion de groupe sur la base de questions ouvertes afin d’aller en profondeur des pensées de chacun d’entre eux, de voir leur vision d’une part, et de produire des hypothèses pour mener une autre recherche descriptive élargie (qualitative et quantitative) ou causale d’autre part.
Un rappel sur les concepts d’entrepreneuriat est abordé : Qu’est-ce que l’entrepreneuriat ?
Qu’est un écosystème entrepreneurial ? Qu’est-ce que l’écosystème de start-up, comment fonctionne-t-il ? Et quels composants sont essentiels au succès ? Quelles sont les perspectives (recommandations) d’un entrepreneuriat prospère en Algérie ?
-
Méthodologie de recherche
Aujourd’hui, notre monde est plus complexe et il est difficile de comprendre ce que les gens pensent et perçoivent. Ainsi, les méthodes de la recherche qualitative, notamment en ligne facilitent la compréhension de ce phénomène, car il s’agit d’une analyse plus communicative.
Alors, pour répondre à un phénomène nouveau, nous avons utilisés la recherche exploratoire qualitative et la recherche documentaire (sources secondaires).
Selon Louis Trudel (2007) cité dans iudenot.com, la recherche exploratoire vise à combler un vide, un préalable à des recherches élargies et sert à clarifier un problème qui a été plus ou moins défini. Elle permet de produire des connaissances sur des phénomènes inconnus.
Selon la même source, pour Mays et Pope (1995), la recherche qualitative est une méthode qui sert à développer des concepts qui aident à comprendre les phénomènes sociaux dans des contextes naturels (plutôt qu’expérimentaux), en mettant l’accent sur les significations, les expériences et les points de vue de tous les participants. Elle permet d’analyser et comprendre des phénomènes, des comportements de groupe, des faits ou des sujets.
La recherche exploratoire est une étude à petite échelle de durée relativement courte, entreprise lorsque l’on sait peu de choses sur une situation ou un problème. Une recherche exploratoire aide à diagnostiquer un problème à développer et affiner plus clairement ses concepts et à formuler des hypothèses3.
La recherche exploratoire qualitative a pour objectif d’obtenir des données de fond de qualité et non des données en quantités.
Nous avons utilisé la méthode d’entretien libre pour le groupe de discussion (ou focus group) avec un sujet prédéterminé, c-à-dire connu par les participants.4
Le groupe de discussion (acteurs de l’écosystème entrepreneurial) auquel 18 personnes ont participé sur la plateforme Teams. Nous avons posé des questions réparties par thème au groupe pour faciliter la discussion sans sortir de l’objectif de collecter le maximum de données sur des aspects particuliers de l’interaction entre les participants qui constituent le groupe, notamment, les perceptions, les réalités du terrain et les perspectives de l’essor de l’entrepreneuriat.
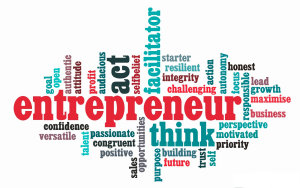
Nous avons choisi cette méthode, car c’est un moyen de réduire le temps pour mener l’étude et faire une analyse approfondie des données tout en obtenant des informations qualitatives détaillées d’une part, ce type de regroupement homogène tend à favoriser des discussions plus intenses et plus libres, de plus notre objet de recherche est de trouver des réponses aux questions « pourquoi », « quoi » et « comment » d’autre part.
Pour ce faire, des entretiens de groupe semi-dirigés (libre) ont été menés auprès des différents acteurs (échantillon) afin de connaître leurs perceptions sur l’entrepreneuriat, l’écosystème entrepreneurial et des startups, les réussites, les obstacles et les perspectives se référant aux situations vécues qui nécessitent des accommodations.
Il existe une variété de méthodes de collecte et d’enregistrement des données. Nous avons choisi la prise des notes manuscrites et des enregistrements vidéo. Les données transcrites avant que le processus d’analyse des données ne puisse commencer. Le logiciel d’analyse utilisé est le N’VIVO. Le Nvivo permet d’organiser et d’analyser des données non structurées ou qualitatives : interviews, réponses libres d’un sondage, articles, médias sociaux et pages Web. Il permet de retranscrire des fichiers audio et vidéo en fichiers textes. Son éditeur intuitif permet de modifier, formater les données et d’individualiser rapidement les différents orateurs et oratrices.
Échantillonnage et déroulement de la collecte des données
Comme notre recherche est exploratoire et qualitative, nous avons choisi un échantillon de 18 acteurs de manière non probabiliste sur la base de quelques critères tels que le poste occupé, le statut et l’expérience de travail, de manière à ce qu’il soit le plus possible homogène et efficace. Nous avons mené des discussions avec le groupe d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial et des startups bien ciblé pour respecter la règle de la représentativité de l’échantillonnage.
Nous avons divisé nos questions ouvertes en trois thèmes distincts,1) connaissances générales sur l’entrepreneuriat, 2) les réussites et les obstacles et enfin 3) les perspectives.
Nous avons contacté le premier groupe Algérie 06 acteurs par courriels et phone (2 entrepreneurs (startupper) 01 en idéation (universitaire), 01 opérationnel depuis 02 années, 01 représentant du gouvernement, 01 représentant de l’agence de développement de l’entrepreneuriat ,01 un incubateur, 01 représentant du fond des startups.
Nous avons fait 02 rencontres sur Teams en un intervalle de 03 mois jusqu’à saturation et chaque rencontre a durée 04 heures.
Nous avons procédé de la même manière pour le groupe d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial et des startups du Québec sauf que dans cet échantillon de 12 participants nous avions rajoutés, un enseignant du primaire, du secondaire, un enseignant universitaire, un mentor, un responsable de la protection des consommateurs et un facilitateur.
Cependant, comme il s’agit d’une recherche exploratoire qualitative avec des limites, notamment en termes de précision d’échantillonnage et de généralisation des résultats. Par conséquence, les résultats obtenus des discussions de groupe aident à affiner la portée du sujet de recherche, à transformer des problèmes non définis en problèmes définis, à produire des hypothèses et à déterminer les principales dimensions de la recherche. Cela va servir à une étude plus large ou d’abandonner la recherche à un stade précoce.
La suite dans la prochaine contribution.
1 Les startups en Algérie sont confrontées à des défis tels que l’accès au financement, la complexité du paysage réglementaire, le manque de compétences spécialisées et de talents qualifiés, ainsi que la concurrence sur le marché local et international.
Source : Les Startup en Algérie : Les Pépites De Notre Pays – CommitForce
2 Source : Services du Premier Ministre | Développer un écosystème propice pour favoriser la création et le soutien des start-up (premier-ministre.gov.dz)
3 Source : www.iedunote.com/fr/recherche-exploratoire
4 Différentes Méthodes de Recherche et Collecte de Données (scribbr.fr)



