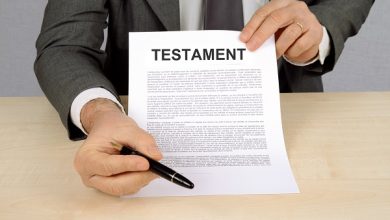Nesrine Ragguem: le parcours fascinant d’une femme à la tête de l’ICM

Derrière chaque grand leader se cache un parcours jalonné d’audace et de persévérance. C’est le cas de Nesrine Ragguem, l’actuelle directrice générale de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM). Dans une interview exclusive, elle se confie sur son cheminement hors du commun, de ses études en Algérie à son ascension fulgurante au Québec. Elle nous partage les qualités héritées de son identité qui ont été des moteurs essentiels, tout en abordant avec franchise les défis qu’elle a dû surmonter. Écoutons-la.
Vous êtes la directrice générale de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM). Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant de prendre les rênes de l’ICM ?
J’ai commencé à exercer comme nutritionniste à la fin de mes études en 2006. Au fil des années, j’ai développé une curiosité pour le fonctionnement des systèmes de santé. Lorsque j’ai entamé des études de deuxième cycle, j’ai choisi de compléter une maîtrise en administration de la santé, avec une spécialisation en gestion intégrée de la qualité et de la performance. À cette époque, les approches d’amélioration continue issues du monde industriel commençaient à influencer l’administration des soins.
Parallèlement, en tant que soignante, j’étais très sensible à la participation pleine et entière des patients dans leurs soins, mais aussi dans l’amélioration de ceux-ci. J’ai profité de mes études pour explorer ces deux thématiques.
J’ai entamé une carrière de gestionnaire en 2014 et occupé différents postes dans plusieurs établissements du réseau. En 2022, j’ai rejoint la direction des services multidisciplinaires de l’ICM. Lorsqu’on m’a proposé, en juin 2024, d’assurer l’intérim de la PDG sortante, j’ai accepté. En décembre 2024, j’ai été nommée PDG à l’issue du processus de sélection.
Pouvez-vous nous parler des activités de l’ICM ? En quoi consiste votre rôle à la tête de cette institution ?
L’ICM est un chef de file en soins, recherche, enseignement et innovation cardiologiques. On y trouve une concentration de savoirs et d’expertises de pointe, reconnue à l’échelle internationale.
Mon rôle consiste à rendre cette excellence accessible aux patients, étudiants et chercheurs, afin qu’elle soit diffusée et partagée au plus grand nombre. Il s’agit d’organiser les différentes missions de l’ICM en gérant au mieux les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles. Ce qui m’importe le plus, c’est que l’excellence demeure le moteur de nos équipes à tous les niveaux, y compris en gestion.
En Algérie, vous avez fait médecine. Comment est venue l’idée d’aller au Canada ?
Je me suis installée au Québec pour des raisons personnelles. À aucun moment je n’ai douté qu’au Québec ou ailleurs, je poursuivrais des études, quelles qu’elles soient. Pour moi, apprendre est un loisir. Le Québec offre cette opportunité d’apprentissage continu. Il y a peu de limites aux ambitions ici. Quand on a soif d’apprendre et de progresser, il existe mille et une façons d’y parvenir.
Votre enfance et vos études en Algérie ont-elles influencé votre parcours professionnel ici au Canada ?
Plus qu’une influence, un véritable conditionnement ! Je suis profondément imprégnée de tout ce qui distingue une Algérienne : ténacité, résilience, vivacité d’esprit, capacités d’adaptation infinies… Ce sont des qualités héritées de mon identité algérienne qui m’ont servi à chaque étape de mon parcours.
J’ai évidemment une liste équivalente de défauts qui viennent avec, mais je vous en parlerai une autre fois 😊
Quels défis avez-vous rencontrés en tant qu’immigrante et professionnelle de la santé ?
À mon arrivée, je manquais de connaissances sur le fonctionnement du système québécois. Je n’avais pas les codes pour en comprendre les rouages. J’ai parfois l’impression d’avoir renoncé trop vite à la médecine. Cela dit, je n’ai aucun regret, car je suis convaincue d’être à ma place aujourd’hui.
Au-delà de cela, je ne peux pas dire que cela ait été plus difficile pour moi du fait d’être une femme immigrante. J’avais les mêmes contraintes que toutes les femmes au Québec : les doubles charges familiales et professionnelles, les plafonds de verre que les femmes rencontrent pour accéder aux hautes fonctions.
Avez-vous des conseils à donner aux étudiants algériens qui souhaitent étudier ici, notamment en médecine ?
L’une des principales caractéristiques des étudiants et professionnels en santé que j’ai observée au Québec, c’est la quête constante du dépassement. Il faut être prêt à ne jamais cesser d’apprendre. L’obtention du diplôme n’est que le point de départ du parcours professionnel. La formation continue est une obligation.
Même si je ne pratique plus la nutrition clinique, je continue chaque année à me former et à rendre des comptes à mon ordre professionnel sur le maintien et le développement de mes compétences.
Justement, quel est l’élément le plus important pour réussir ?
Il n’y a pas un seul élément, mais plusieurs. Chaque individu aura son propre parcours. Pour moi, le premier est de construire ses compétences. Grâce à vos compétences, vous bâtissez votre réseau. Les gens retiennent que vous êtes fiable et seront portés à vous faire confiance. De cette confiance naîtront des opportunités.
Un autre élément qui m’a été favorable, c’est de croire en ma capacité d’apprendre et de m’adapter. J’aurais manqué de belles opportunités si j’avais refusé des projets en me disant que je ne serais pas en mesure de les mener.
Beaucoup de médecins algériens ont pu exercer ce noble métier, notamment en France après une mise à niveau de leurs diplômes. Pourquoi cet exercice n’est-il pas aussi réussi par nos compatriotes ici au Canada ?
L’accès aux études médicales demeure difficile encore aujourd’hui. Les centres universitaires sont prêts à soutenir des candidatures étrangères, mais le niveau de distinction et d’excellence des candidats doit être exceptionnel. Il faut avoir une valeur ajoutée à apporter aux soins, à la recherche et à l’enseignement pour espérer se faire remarquer. La compétition est forte et le niveau d’exigence est extraordinairement élevé.
Je le constate au quotidien au contact des médecins avec lesquels je travaille : ils ne prennent jamais rien pour acquis.
Un des éléments qui affaiblissent la réputation de notre formation en Algérie, c’est le manque de formation continue, la faiblesse de la recherche médicale et le faible accès aux innovations scientifiques et technologiques.
Nos étudiants et médecins fournissent énormément d’efforts dans leur parcours d’études, car ils doivent compenser ces manques. C’est pour cette raison que, lorsque certains arrivent à intégrer le système québécois et à combiner leur capacité de travail avec les moyens d’ici, ils finissent par exceller.
Combien de médecins algériens ou d’origine algérienne exercent ce métier au sein de votre institution ?
Je ne saurais vous le dire. Nous ne tenons pas de statistiques sur la base des origines de nos médecins.
Profession réglementée, difficulté de reconnaissance des diplômes et expériences pour les médecins étrangers, notamment maghrébins, coûts trop élevés des études… Pourquoi, selon vous, faire médecine au Canada devient-il presque impossible, notamment pour les Algériens ?
Voir réponse plus haut. Par contre, c’est aussi accessible aux Algériens nés ou ayant grandi ici qu’à n’importe quel Québécois. Et je constate avec joie que plusieurs jeunes Algériens sont admis dans les facultés de médecine.
Le Canada, ce beau pays qui attire davantage d’immigrants, est malheureusement réputé pour son système de santé complexe et souvent décrié par les patients (longs délais pour les rendez-vous, heures d’attente aux urgences, difficulté d’avoir un médecin de famille…). Le système de santé québécois est-il malade ?
Heureusement, lorsque les citoyens ont besoin de soins urgents et complexes, ils reçoivent des soins parmi les meilleurs au monde. Cependant, il existe effectivement un défi d’accès aux soins primaires et de proximité.
Il faut trouver un équilibre entre l’excellence, qui coûte cher, et l’accessibilité, dans un contexte où la prévention des maladies chroniques a été négligée pendant des décennies. Il y a aussi un défi démographique indéniable lié au vieillissement de la population. Tout cela augmente considérablement les besoins et met à mal la capacité de payer de l’État.

En tant que dirigeante d’un établissement de santé, je suis engagée, avec la nouvelle société d’État créée en décembre dernier, Santé Québec, dans une démarche de transformation du réseau à la recherche de ce fameux point d’équilibre. Nous sommes résolus à mettre tous les efforts pour faire autrement et obtenir de meilleurs résultats.
On parle beaucoup, ces temps-ci, de la diaspora algérienne vivant à l’étranger et de ses capacités à contribuer aux efforts de recherche et de développement en Algérie. Concrètement, quel apport pourrait avoir cette diaspora à l’Algérie, un pays qui a toujours besoin de ses enfants ?
Chaque Algérien est prêt à redonner à l’Algérie. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Ce que nous apprenons en vivant à l’étranger, c’est que les façons de faire d’ici sont totalement complémentaires et compatibles avec celles de l’Algérie. Enrichir le savoir-faire algérien d’un savoir-faire étranger peut décupler les bénéfices pour le pays.
Ce qui nous aiderait, ce serait de rendre les échanges plus fluides et de permettre des initiatives innovantes de partage. Mais cela ne se fera pas sans infrastructures de recherche ni sans engagement clair pour les soutenir.